L’observatoire des libertés et du numérique (OLN) dont CREIS-TERMINAL est membre fondateur, organise les 6 et 7 juin un colloque
Bilan critique de la loi Renseignement de 2015 et d’une décennie de répression administrative
Vendredi 6 juin
Participation à prix libre, sur inscription requise via ce formulaire.
Lieu : Auditorium de la maison des avocats, 11 Rue André Suares, 75017 Paris (à côté du Tribunal judiciaire).
Matinée : Bilan critique de la loi sur le renseignement de 2015
9h-12h30 – Modération : Noémie Véron, maître de conférences en droit public à l’Université de Lille.
Point de vue d’un sociologue : Didier Bigo, rédacteur en chef de la revue « Cultures et Conflits » et professeur émérite à Sciences Po / CERI, spécialiste de la sociologie politique internationale et co-auteur de l’ouvrage « Intelligence Oversight in Times of Transnational Impunity » ;
Point de vue d’un juriste : Lilian Dailly, maître de conférence en droit public à l’université de Poitiers, auteur de la thèse « Le renseignement : étude de droit public », publiée en juin 2025, éd. Mare & Martin ;
Point du vue de la société civile : les propositions de l’Observatoire des Libertés et du Numérique pour améliorer le contrôle et les limites des services de renseignement, Félix Tréguer (membre de l’association La Quadrature du Net) et Nohra Boukara (membre du Syndicat des avocat·es de France);
Point de vue d’une journaliste : Camille Polloni, journaliste à Mediapart, spécialiste des questions de police ;
Point de vue d’une personne concernée : « L’assignation à résidence : une mesure privative de liberté délétère prolongeant le spectre de l’incarcération », Kamel Daoudi, ingénieur d’études en informatique, assigné à résidence depuis 17 ans (à distance) ;
Après midi : État d’urgence de 2015, 10 ans de dérives des répressions administrative
14h-17h30 – Introduction et modération : Judith Allenbach du Syndicat de la magistrature.
Table ronde avec la participation de :
- Anne Charbord, juriste spécialiste des droits humains, engagée auprès des rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la protection des droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre le terrorisme ;
- Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit public à l’université Paris-Nanterre ;
- Nicolas Klausser, Chargé de recherche, Sociologie et sciences du droit au CNRS ;
- Vincent Louis1, Doctorant en droit public à l’Université Paris Nanterre ;
- Lucie Simon, avocate, membre du Syndicat des Avocat·es de France ;
- Sihem Zine, juriste, fondatrice de l’association Action droits des musulmans.
Lors de cette après midi seront évoqués différents thèmes permettant de croiser les différents regards des participant·es :
– les abus de la lutte antiterroriste dans une perspective internationale ;
– une mise en perspective critique de l’ensemble des mécanismes de police administrative mis en place ces dix dernières années ;
– les abus du recours aux MICAS (mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) ;
– le recours aux notes blanches : le droit des étrangers comme laboratoire de l’antiterrorisme administratif ;
– les abus racistes et islamophobes des répressions administratives : exemple du contrôle des comptes bancaires et des fermetures administratives d’associations ;
– la fuite en avant des outils technosécuritaires de contrôle « préventif » ;
– les abus du recours à l’accusation d’apologie du terrorisme et à la censure administrative qui lui est liée ;
– les dissolutions d’associations ;
Ces thématiques permettent de mettre en lien les enjeux liés à l’accumulation des lois sécuritaires et leurs effets cliquet, les limites aux contre-pouvoirs et, plus généralement, la dérive autoritaire chaque jour plus inquiétante à nos yeux.
17h30 – Nathalie Tehio, présidente de la Ligue des droits de l’Homme.
Samedi 7 juin
Après-midi et soirée grand public : Quelles résistances face à la répression et la surveillance ?
Lieu : Les Amarres, tiers lieu, 24 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris.
Entrée libre.
Une après-midi remplie d’ateliers, de conférences, de projection et échanges pour faire le point sur 10 ans de dérives autoritaires et comment y résister, suivie d’une soirée pour célébrer nos luttes.
13h30h : Accueil
13h45 : Discussion – Retour sur la dernière décennie de répression : quel constat ? comment lutter ?
Avec les membres des associations de l’Observatoire des Libertés et du Numérique dont Dominique Desbois, membre du CA de CREIS-TERMINAL : Technologies numériques : au service de la sécurité globale ou instrument du contrôle social ?
14h45 – 16h45 : Atelier – Compréhension et échange sur les outils de surveillance étatique
15h00 – 16h00 : Atelier – Comprendre comment utiliser les outils juridiques (CADA, CNIL) pour obtenir de l’information des administrations et documenter les politiques de surveillance
Par Technopolice Paris-Banlieue
15h – 17h : Discussion – Table ronde sur les violences d’État
Avec le Collectif de soutien aux inculpé·es du 8 décembre, la Coordination contre la répression et les violences policières Paris-IDF, la campagne contre la dissolution d’Urgence Palestine
16h45 – 18h15 : Atelier – Autodéfense numérique : Insécurités numériques et militantismes, comprendre les menaces pour anticiper les risques
Par l’Interhack
17h – 18h15 : Atelier – Militants/manifestants, s’opposer au fichage : mode d’emploi
Par des membres du SAF et du Syndicat de la magistrature
17h : Atelier – Présentation de l’outil Attrap (Automate de Traque de Termes et de Recherche dans les Arrêtés Préfectoraux) permettant d’effectuer des recherches dans les recueils des actes administratifs (RAA) des préfectures
Par La Quadrature du Net
18h15 : Projection du Film « Le Repli » suivi d’une discussion
20h : Concerts et DJ
Tables et stands :
- Technopolice Paris-Banlieue ;
- Ligue des droits de l’Homme, avec notamment la présentation des jeux « »On lâche rien ! » et « Rien à cacher ! » et de la documentation sur nos droits en manifestation et face à la police ;
- Coordination contre la répression et les violences policières Paris-IDF ;
- Interhack – Infokiosque ;
- Observatoire des Libertés et du Numérique et ses invité·es
Les associations de l’Observatoire des Libertés et du Numérique : Globenet, Creis-Terminal, la Ligue des droits de l’Homme (LDH), Amnesty International France, Le Syndicat des avocat·es de France (SAF), le Syndicat de la Magistrature (SM), le CECIL et La Quadrature du Net (LQDN).
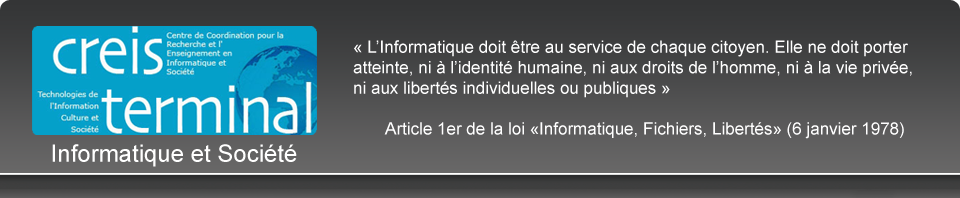
 LDH – Fichage institutionnel
LDH – Fichage institutionnel TERMINAL
TERMINAL Cecil
Cecil David Fayon
David Fayon EPI
EPI IFIP TC9
IFIP TC9 IRIS
IRIS Jeunes Espoir 2000
Jeunes Espoir 2000 LDH Toulon
LDH Toulon SIF
SIF VECAM
VECAM